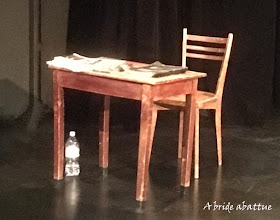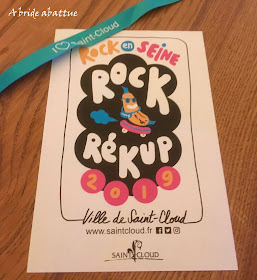On pensait que
Philippe Delerm avait décrit chacun de nos travers et marottes, mais voilà qu'il publie un nouvel opus de nouvelles,
L’extase du selfie et autres gestes qui nous disent, compilant 47 attitudes ou comportements qu'il analyse avec précision et érudition.
Le recueil commence par une pratique qui s'intensifie tellement qu'on envisage de la prohiber dans les lieux publics, le vapotage, dont il est très vrai qu'on est parfois choqué de voir l'adepte biberonner en retrait, visage penché, regard fuyant cette cigarette d'un nouveau genre (p.7) en s'adonnant à ce rituel d'autodestruction qu'on a cru d'abord inoffensif.
On retrouve le Delerm sarcastique, fustigeant le vapotage. Le Delerm ironique remarquant qu'on garde le verre à la main, au lieu de le porter à ses lèvres (p.11), comme on regarde son whisky sans le boire (p. 86), deux façons de faire qui dispensent l'auteur d'ajouter "à consommer avec modération".
Le Delerm indulgent aussi à l'encontre des utilisateurs (j'aurais envie d'écrire "amuseurs") de téléphone qui célèbrent leur intimité dans le souffle de l'air hivernal (p. 32). Il faut croire qu'il prend peu les transports en commun pour voir de la beauté et de l'enchantement dans ce qui est surtout une incivilité.
Le Delerm lucide qui considère le livre comme un objet d'une valeur ambigüe -affective et marchande, conscient qu'il est fait pour dépasser nos vies, nos rituels, et nos soirées ensemble (p. 50).
Le Delerm romantique pour qui faire les carreaux, c'est célébrer les noces du dehors et du dedans, maîtriser un peu de mat dans le jour ébloui (p. 54).
On lira cet opus comme on regarderait une vidéo de vacances, avec ses images estivales de pétanque, de verre de vin, de carte qui n'arrive pas, de plage, de fontaine ... et puis on le jugera intemporel lorsque viendra avec Noël le moment d'éplucher d'une seule main la clémentine (p. 23).
On lira tout. On appréciera tout en acquiesçant, même à ces pages sont les enjeux nous échappent, ne comprenant pas pourquoi l'auteur remercie Isabelle Carré (p.28).
La veine narrative fouille loin, extirpant la montre du gousset, s'attardant sur les mains de Mona Lisa, cherchant l'inspiration en musique (qui apparait dans cinq titres) ou dans la rondeur d'une boule de pétanque, d'une balle de tennis, d'un caillou propice aux ricochets.
Philippe Delerm ne se lasse pas d'explorer nos rituels d'appartenance ... ou de différenciation, voyant parfois des mystères là où il faut imputer une anomalie morphologique, croyez-en l'expérience d'une femme dont les épaules fuyantes ne retiennent aucune bretelle (p. 66).
L'auteur serait-il devenu misogyne ou est-ce ma lecture qui est plus attentive ? J'ai relevé la citation condescendante (quoique aimable) de Sempé : Mais où se cachent donc en hiver toutes ces femmes charmantes qui nous reviennent au printemps ? (p. 45) et sa manière de désigner la ménagère comme une amazone domestique remplissant dans les rayons du supermarché sa mission coursière avec frénésie (p. 60). Elle se regarde l'écouter, lui qui doit continuer à parler, et puis la regarder se taire (p. 104).
Qu'elle remue les cheveux et il y voit un opéra pour pas grand chose (p. 78) et je me suis demandé ce que ces textes auraient de savoureux si le propos était inversé, comme dans le film de la réalisatrice Eléonore Pourriat Je ne suis pas un homme facile, nous invitant à échanger les rôles entre hommes et femmes afin de pointer du doigt l’absurdité de notre société.
Philippe Delerm devient anthropologue avec La pavane des draps pliés (p. 90) qui ne parlera plus à personne dans quelques années, les housses de couette ayant définitivement remplacé les draps de lin de nos grands-mères.
Avec bien sûr, L'extase du selfie qui donne son titre à l'ouvrage et ce dernier texte, Ensemble loin, après avoir été si proches. Ces pages se répondent en quelque sorte même si je doute que Philippe soit fin connaisseur dans l'art du selfie car ce qui caractérise le plus ce type de photographie n'est pas le soi qui serait soudain avantageux (ou avantagé). Se photographier devant un monument a toujours été un travers du touriste de masse. Combien d'entre nous ont été sollicités pour immortaliser un couple de gentils touristes ?
Ce qui, de mon point, est radicalement différent avec le selfie est, comme son nom l'indique, cette indépendance que le geste assure. Nul besoin d'attendre le bon vouloir d'un chaland. On se tire le portrait quand on veut, où on veut. Mais ce qui fait la différence entre ce type de prise de vues et une photographie "classique" c'est la direction du regard qui n'est que très rarement saisi par l'objectif du smartphone. Le sujet semble ailleurs, happé par une dimension qui échappe à tous ceux que, paradoxalement, le cliché est censé captiver.
L’extase du selfie et autres gestes qui nous disent, de Philippe Delerm, éditions Le Seuil, en librairie le 12 septembre 2019
Le selfie qui illustre l'article a été pris à Taxco (Mexique) en décembre 2018.
 La rentrée littéraire concerne autant les jeunes que les adultes. Sous peine de radoter j'ajouterais que les grands gagneraient à lire cette littérature dite "jeunesse" qui concerne tout le monde.
La rentrée littéraire concerne autant les jeunes que les adultes. Sous peine de radoter j'ajouterais que les grands gagneraient à lire cette littérature dite "jeunesse" qui concerne tout le monde.