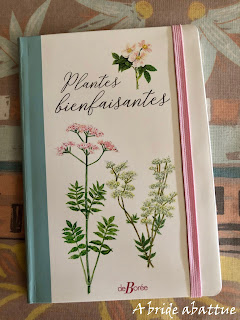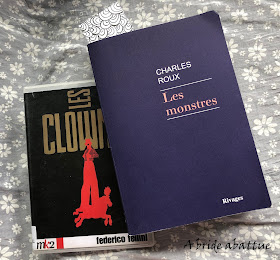C'est un de ces petits miracles inattendus des vide-greniers quand on tombe par hasard sur un auteur qu'on apprécie, et que l'on peut, pour une somme quasi symbolique, acquérir un ouvrage dont on sait à l'avance qu'on appréciera la découverte.
Je connais
Arthur Le Caisne, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter au moment de la sortie de son premier livre,
La cuisine c'est aussi de la chimie. Je l'ai lu et relu régulièrement. Et prêté aussi beaucoup de cuisiniers.
Le titre de celui-ci, paru alors que le Covid allait bientôt nous éloigner des restaurants, n'était pas pour me faire peur. Je sais qu'Arthur va nous expliquer Pourquoi les spaghetti bolognese n’existent pas.
Cette question ne m'empêchait pas de dormir. Je savais qu'il fallait rincer plusieurs fois le riz blanc avant de le cuire mais j'ignore encore beaucoup de choses sur les pâtes. Vous devez penser que je vais vous donner la réponse à la question du titre du livre mais il vous faudra la chercher (p. 116), très argumentée, comme l'auteur excelle à le faire.
J'ai pioché une foultitude de secrets et de contre-vérités, à propos de plein de choses, comme je m'y attendais. Chacune des affirmations repose sur les études et expériences scientifiques les plus récentes, et est toujours livrée avec une bonne dose d’humour et de bienveillance.
Apprendre et comprendre pourquoi il faut saler l’eau de cuisson de certains légumes mais pas d’autres, pourquoi un pot-au-feu préparé la veille est meilleur, pourquoi il faut mettre les haricots verts à cuire à l’eau bouillante et les pommes de terre à l’eau froide (c'est comme certaines règles d'orthographe, j'ai du mal à le mémoriser).
Bien sûr, il y a des trucs et astuces très utiles, alors que d'autres informations sont plus anecdotiques. On sait que la tomate est un fruit mais moins que les fraises et les pommes sont des légumes, et bien entendu Arthur justifie l'affirmation selon laquelle tous les fruits sont des légumes, mais que la réciproque n'est pas juste (p. 170).
Ce livre aux allures de Quid répond à plus de 700 pourquoi, dont vous pourrez tirer la substantifique moelle pour régaler vos invités à l'apéritif, … puisque, après des mois de restrictions sanitaires, cette activité va être de nouveau permise.
Vous saurez tout sur tous les aliments, légumes, viandes, poissons, lait, pâtes, œufs, mais aussi les méthodes de cuisson, les batteries de cuisine, il apporte des réponses qui autrefois nous étaient transmises par nos grands-mères. Comme le secret de la bouteille pour rattraper une crème anglaise (p. 78). Ou du vocabulaire approprié. Ainsi on déveine un foie gras. On ne le dénerve pas.
Je tiens de la mienne une grande part de ce précieux savoir. Mais j'ai appris avec Arthur que le diamètre du rouleau à pâtisserie était déterminant pour obtenir une abaisse fine et régulière (p. 13) et je vais à l'avenir me servir d'une bouteille. J'ai compris l'intérêt de découpe d'une viande épaisse avec un couteau à pain (p. 18).
Je savais que la cuisson du poivre le rendait amer et qu'il ne fallait pas l'acheter moulu. Mais j'admets désormais que le sel n'est pas un exhausteur de goût mais un modificateur de saveurs. Désormais, quand je le pourrai, je salerai mes viandes la veille de leur cuisson. Et je saurai comment obtenir une peau croustillante au poulet cuit au four (p. 134).
J'utilise énormément de feuilles de laurier mais j'ai appris l'intérêt d'en retirer la nervure centrale pour une meilleure diffusion des saveurs. Les plantes aromatiques doivent s'utiliser différemment selon qu'elles sont ligneuses (thym, romarin …) et alors être placées en début de cuisson ou herbacées (basilic, estragon) et alors en fin de cuisson. Il me reste à progresser dans la découpe et l'emploi des gousses d'ail et des oignons. Quant aux piments, sur lesquels je savais beaucoup de choses, Arthur m'apprend que ce ne sont pas les graines qu'il faut retirer mais la peau blanche pour qu'ils ne soient pas trop piquants. Cela ouvre des perspectives d'emploi des dites graines.
Et je suis bien contente d'avoir une preuve scientifique pour justifier de ne jamais conserver mes oeufs au réfrigérateur (p. 91), contrairement aux remontrances (donc injustifiées) qui me sont faites. Pareillement pour ne plus consommer la peau des pommes de terre.
Je vais améliorer ma façon de préparer les moules en les nettoyant à l'eau courante (on ne fait jamais tremper ces mollusques là) avant d'arracher leur byssus (p. 153). Depuis cette lecture, j'ai corrigé ma recette de
moules marinières. Et je m'engage à avoir le réflexe de jeter l'eau des huîtres à leur ouverture pour qu'elles lâchent ensuite une seconde eau, qui viendra de leurs tissus et qui sera beaucoup plus savoureuse que la première qui n'est rien d'autre que de l'eau de mer.
Quant aux modes de cuisson des viandes, poissons et même légumes, j'ai déjà pris désormais la bonne habitude de mettre l'huile sur les aliments plutôt que dans le plat de cuisson, mais j'avoue qu'il me reste encore à apprendre. Ce livre m'est devenu indispensable !
Pourquoi les spaghetti bolognese n’existent pas d'Arthur Le Caisne, Marabout, collection Beaux-livres cuisine, en librairie depuis le 2 octobre 2019