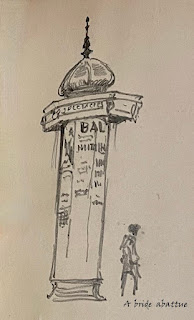La façade rouge du Théâtre des Gémeaux parisiens s’accorde totalement avec Les caprices de Marianne mis en scène par Philippe Calvario.
La façade rouge du Théâtre des Gémeaux parisiens s’accorde totalement avec Les caprices de Marianne mis en scène par Philippe Calvario.Quelle bonne idée il a eu d'engager la merveilleuse Zoé Adjani pour incarner cette femme qui n'est pas plus un dragon de vertu qu' une mince poupée qui dit non.
Après une création à la Comédie de Picardie en novembre 2024, la pièce s'est donc installée sur la scène de l'Est parisien la plus à l'Ouest depuis le 16 janvier et y restera jusqu'au 30 mars 2025.
Le jeune Cœlio rêve de conquérir Marianne, épouse du juge Claudio. N'osant l'aborder, il tente d'abord d'utiliser l'entremise de la vieille Ciuta, qui n'obtient rien de la jeune femme que l'affirmation de sa fidélité conjugale.Cœlio se tourne vers un autre entremetteur, son ami Octave, bon-vivant et libertin et cousin du mari de Marianne, Claudio. Marianne reste indifférente à Cœlio, mais tombe amoureuse d'Octave ; elle lui dévoile son amour à mots couverts et lui fixe un rendez-vous. Octave, d'abord indécis, choisit la loyauté et envoie Cœlio au rendez-vous obtenu.Cependant, Claudio soupçonne l'infidélité de sa femme et engage des spadassins pour tuer tout amant qui s'approcherait de la maison. Cœlio tombe dans le guet-apens et, mourant, peut croire à la trahison de son ami en entendant Marianne, trompée par l'obscurité, l'accueillir du nom d'Octave.Octave, accablé, renonce à sa vie de plaisirs et repousse sèchement l'amour que lui déclare Marianne.
Je ne sais pas au final si la pièce d'Alfred de Musset est horriblement misogyne ou furieusement féministe. En tout cas la dialectique est permanente dès qu'Octave (Philippe Calvario) lance la conversation, que ce soit avec Coelio ou avec Marianne. Les joutes oratoires s'enchaînent. Par exemple :
Coelio : Que tu es heureux d’être fou.
Octave : Que tu es fou de ne pas être heureux.
Octave : Que tu es fou de ne pas être heureux.
Le mari (Christof Veillon), stupidement soupçonneux, ne fait que geindre, se plaignant qu'il pleut des guitares et des entremetteuses sur sa maison, et ne provoque aucune empathie. Coelio (Mikaël Mittelstadt, alias Greg Delobel de Ici tout commence), certes grandement épris, agace à ne pas comprendre que Marianne est libre de ne pas tomber amoureuse de lui.
L'excès de ses emportements devient vite lassant : Je machine une épouvantable trame et me sens prêt à mourir de douleur (…) Ou je réussirai ou je me tuerai. (…) Dis-lui que me tromper, c’est me donner la mort, et que ma vie est dans ses yeux.
En tant que spectatrice, je ressens vite leur joute oratoire comme une forme de harcèlement. Comment peut-on oser parler d’une femme comme "d’une belle nuit qui passe" ?
Octave est immensément odieux dans sa volonté de manipulation, voulant faire croire à Marianne (Zoé Adjani ) au désintérêt soudain de Cœlio. Par quel mystère ? interroge-t-elle.
Celui de l’indifférence prétend son cousin. Vous ne pouvez aimer ni haïr et vous êtes comme les roses du Bengale Marianne sans épines et sans parfum.
Mais à peine avais-je songé que mon opinion était peut-être influencée par le mouvement #Me Too que voici Marianne qui élève la voix, s'enflamme et retourne la situation : Je croyais qu’il en était du vin comme des femmes.
Elle nous offre alors une scène d’une intensité bouleversante, d’autant plus que jusque là elle s’exprimait dans une grande retenue. Sa colère est celle de toutes les femmes, aucunement exagérée. Ce qu’il faut de maitrise pour jouer avec tant de justesse !
Philippe Calvario est un excellent directeur d’acteurs (on se souvient, j’espère, de Jane Birkin en Electre en 2005). Je comprends son intérêt pour ce texte qu’il nous fait re-découvrir et dont sa mise en scène souligne la ronde infernale des personnages, qui se débattent entre désirs fantasmés et désirs forcés. Comme s’ils courraient tous vers le pire dans une sorte d’urgence, sans pourtant le vouloir.
Celui qui avait mis en scène Cymbeline de Shakespeare en 2000 aux Amandiers sur proposition de Jean-Pierre Vincent retrouve avec Les caprices deux thèmes qu’il affectionne, l’innocence et la jalousie. A noter qu’il est tout autant metteur en scène (dans de multiples excellents spectacles) que comédien. Je me rappelle particulièrement de lui dans Une maison de poupée, mise en scène de Philippe Person (où Nathalie Lucas, directrice des Gémeaux, était sa partenaire).
C’est un plaisir de le voir se glisser dans le rôle ambigu d’Octave qu’il nous rend sympathique malgré ses excès et ses manipulations, si lourdes de conséquences. Peut-être parce que, de tous les personnages de la pièce il est le seul à ne pas savoir aimer. On le plaint donc de ne ressentir comme sentiment amoureux que l’ivresse passagère d’un songe.
A ses côtés on retrouve Delphine Rich qui a l’occasion de passer de la tenue de domestique de Ciuta à celle, plus raffinée, d’Hermia, la mère de Coelio. Et Hameza El Omari qui, en quelque sorte, synthétise tous les valets.
Les caprices de Marianne d' Alfred de Musset
Adaptation et mise en scène : Philippe Calvario
Avec Zoé Adjani, Philippe Calvario, Mikaël Mittelstadt en alternance avec Pierre Hurel (les 5, 6, 12, 13 et 19/03/2025), Hameza El Omari, Delphine Rich, Christof Veillon
Collaboration artistique : Sophie Tellier
Scénographie : Roland Fontaine
Costumes : Aurore Popineau
Création musicale : Christian Kiappe
Création lumière : Christian Pinaud
Régie générale : Sébastien Alves
Administrateur de la cie : Daniel Rouland
Dramaturgie : Modestine Pelle